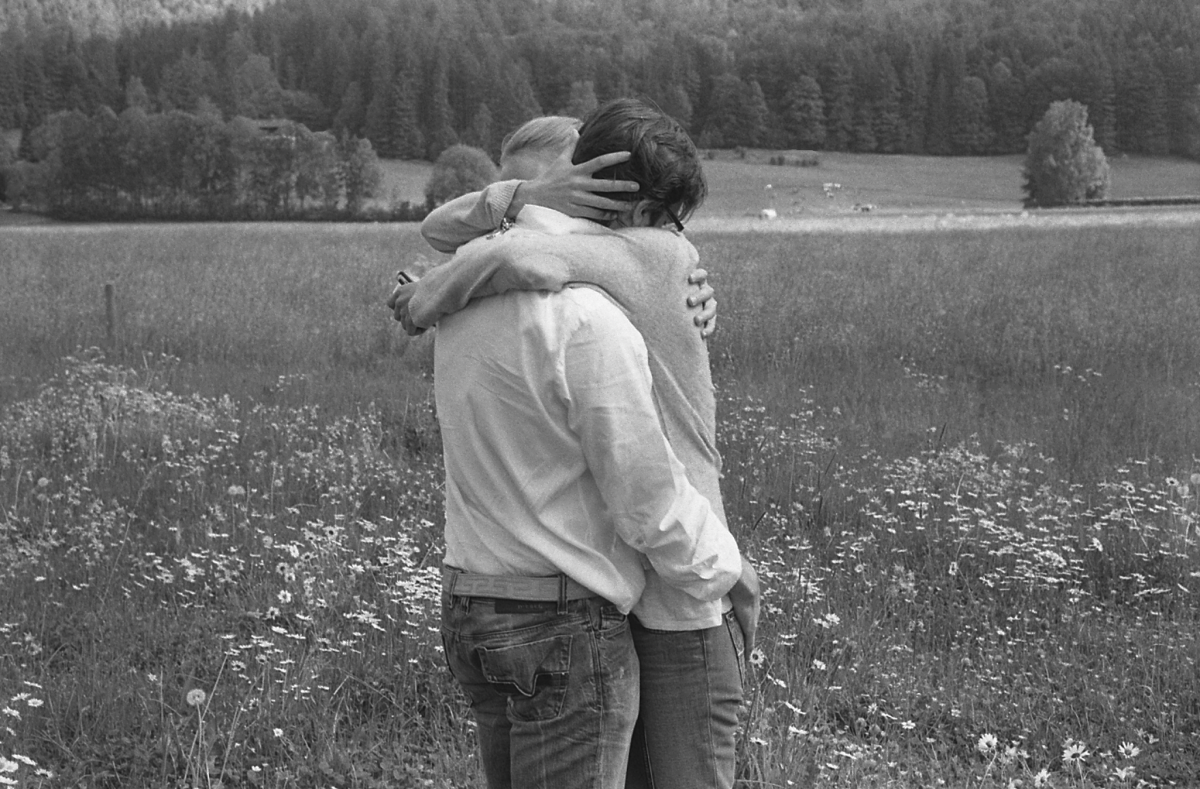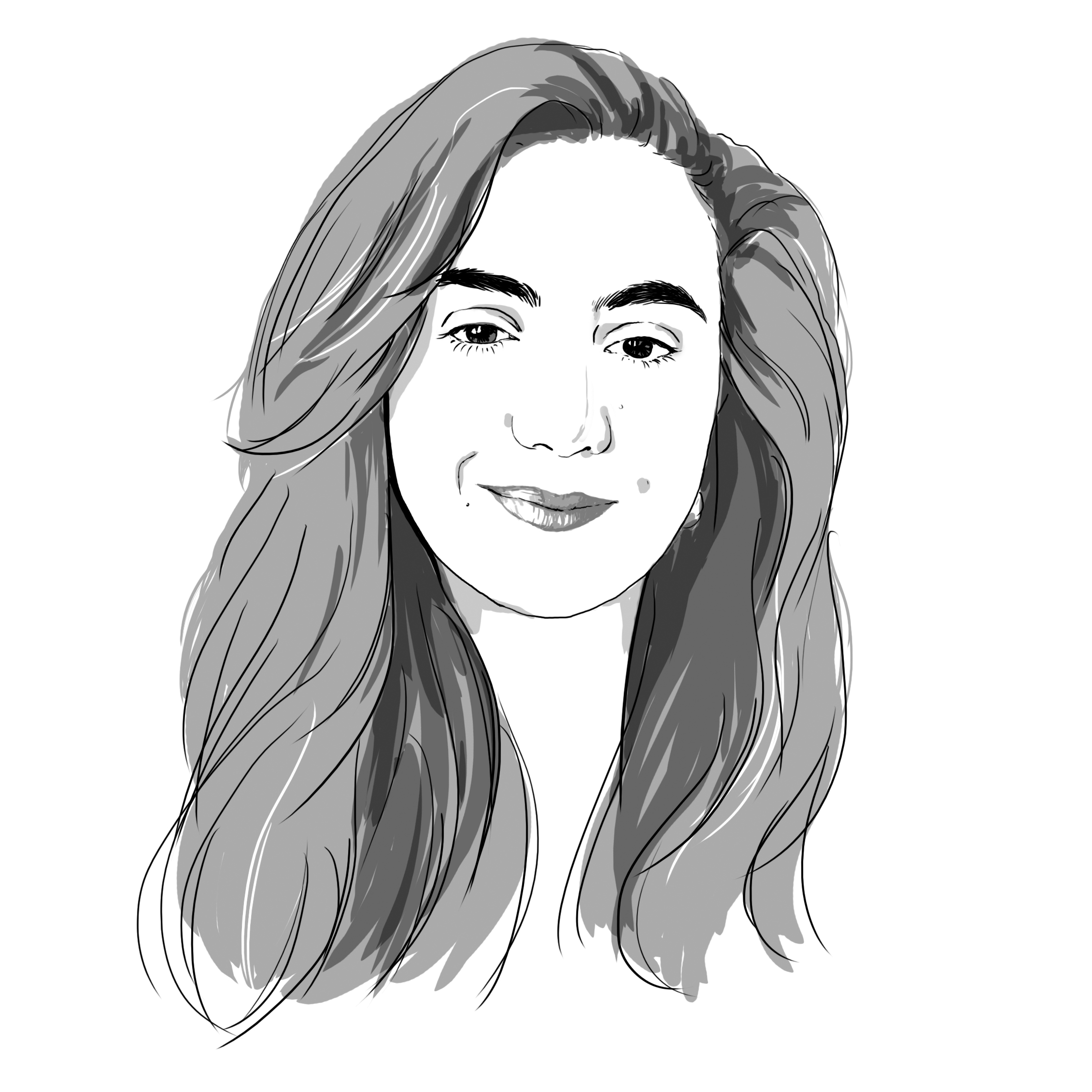La théorie économique libérale part d’un postulat simple : richesse économique, libéralisme et bonheur sont étroitement liés. Dans ce paradigme, la poursuite par chacun de ses intérêts privés sert inexorablement les intérêts des autres et conduit par truchement au bonheur collectif. Plusieurs siècles ont mis à mal ce postulat. Ni l’économie, ni les entreprises, dans la façon dont elles sont structurées aujourd’hui ne conduisent au bonheur collectif. Bien au contraire, elles participent activement à renchérir les crises sociales et environnementales du XXIe siècle.
Contribuer à la “vie heureuse”
Pourtant, l’intuition des pères fondateurs de l’économie n’est pas infondée. Les entreprises, organisations sociales et matérielles œuvrant pour la production de biens et de services, ont un rôle fondamental à jouer dans ce qu’Aristote appelle “la vie heureuse”. Pour lui, le bonheur prend source dans l’organisation sociale et politique de la cité, et la cité dans toutes ses composantes a la responsabilité de faire advenir cette “vie heureuse”.
Si les entreprises ne sont pas seules chargées de rendre les gens heureux, elles peinent à remplir le rôle qui leur incombe dans cette tâche collective. Cela ne doit pas les décourager. Mais pour faire leur part, elles doivent se débarrasser d’un certain imaginaire du bonheur et du progrès, qui les empêche de contribuer au bonheur collectif.
Désencastrement de la société et de la Planète
L’imaginaire du bonheur qui sous-tend le système économique actuel réduit le bonheur à l’enrichissement économique, à la possession matérielle et à une forme de réussite univoque qui se situe toujours dans un “ailleurs”. John Dewey résume parfaitement l’esprit de cet imaginaire :
“[Les libéraux] pensaient que le progrès social ne pouvait advenir que de l’entreprise privée au plan économique, non dirigée au plan social, avec pour fondement et pour aboutissement le caractère sacré de la propriété privée, i.e. l’absence de contrôle social. Ils attribuent à ce seul facteur tous les progrès sociaux qui ont eu lieu, comme l’augmentation de la productivité et l’amélioration des conditions de vie. [...] Ils ont tenté de faire suivre au progrès une trajectoire unique qu’ils voulaient rendre immuable” (J.Dewey, 1935).
Dans un tel imaginaire, le but de l’entreprise est cantonné à la production de biens et de services en nombre toujours croissant, et dont l’unique objectif est de générer de la valeur économique, censée “ruisseler” pour “faire le bonheur” du plus grand nombre. Les autres formes de valeur, qu’elles soient sociales ou environnementales, sont appréhendées comme des externalités positives ou négatives, vues par le simple prisme de l’impact (et plus récemment de la responsabilité). Elles demeurent donc hors-système : en dehors du modèle et donc de la mesure de sa réussite ou de son échec. Toute valeur non financière devient une valeur “extra” : extra-financière, extra-économique, extra-marchande.
Une réflexion profonde sur leur objet même
Le paradigme libéral est capable de survivre à deux conditions : un cadre social et environnemental viable et un partage équitable de la richesse économique entre toutes les parties prenantes. Or ni l’une, ni l’autre de ces conditions ne sont remplies dans le système actuel. Le paradigme est à bout de souffle. Les nombreuses crises sociales, politiques et environnementales qui traversent notre époque en attestent. Toutes appellent les entreprises à réaliser leur objectif fondateur : contribuer à la création et au maintien des conditions économiques, physiques et sociales pour que la vie heureuse devienne possible et y advienne. L’entreprise ne peut ainsi plus se contenter de produire de la seule valeur économique, elle doit œuvrer par son activité à préserver un cadre social et écologique viable, juste et sûr par la protection voire la régénération des écosystèmes sociaux et écologiques.
Ce changement profond ne relève pas de la Responsabilité Sociale et Environnementale de l’entreprise, perçue (à raison) comme une charge supplémentaire. Les entreprises doivent développer une réflexion profonde sur leur objet même, et sur les formes de valeur qu’elles produisent par leur activité. Pour cela, elles doivent renouer avec une vision holistique de leur activité, seule capable de donner du sens à leur existence et de créer de l’adhésion autour de leur projet. L’écart est grand : elles doivent assumer qu’elles sont des “industries de la vie” : à la fois et en même temps créatrices de liens à l’intérieur et à l’extérieur de l’organisation, producteurs de richesse économique et régulateur d’écosystèmes naturels. Sans l’un ou l’autre de ces piliers, l’entreprise risque de perdre son intégrité.
Mais qu’est-ce que la valeur ?
La valeur est au centre de l’économie car elle lui permet d’exister. Dans sa conception théorique, elle est l'appréciation sur le plan moral ou intellectuel de la qualité d'une “chose” matérielle ou immatérielle qui la rend digne d'estime aux yeux d’une personne ou d’un groupe.
Notre modèle de création de valeur est assez simple. Elle est produite par la réponse à un seul type de besoin : celui du consommateur. Les êtres humains, les citoyens, les milieux naturels sont exclus de son champ. Cette vision tronquée de l’être humain réduit à son pouvoir d’achat et déconnecté de ses milieux sociaux et naturels produit de la valeur contrefaite et incomplète, et participe à la “désolation du monde” longuement documentée par Hannah Arendt. Cette désolation déstabilise le système. Les crises et bouleversements du XXIe siècle ne sont que l’écho de cette douloureuse évolution, incompatible avec les dimensions du globe, et avec le bonheur individuel.
Les entreprises qui créeront de la valeur demain seront celles qui parviendront à développer une compréhension profonde de leur participation égale à la valeur sociale, économique et environnementale, et à raconter cette contribution au bonheur, à créer une nouvelle convention entre elles et les consommateurs, à faire avancer l’histoire des idées. En un mot, à apporter des réponses justes aux besoins des êtres humains (=valeur sociale), de la Planète (=valeur environnementale) et des consommateurs (=valeur économique).
C’est ambitieux, mais les entrepreneurs le sont. L’exercice ne requiert ni perfection, ni visée de vertu. Intentionnalité et expérimentation sont les maîtres mots de cette démarche. De nombreuses entreprises s’essaient déjà (certains depuis longtemps, tel le modèle mutualiste) à produire de nouvelles formes de valeur, comme Nexans avec l’E3 ou Léa Nature aujourd’hui. L’exemple de l’entreprise Léa Nature est particulièrement parlant. Pour l’entreprise, la rentabilité n’est plus une finalité en soi mais une contrainte à gérer parmi une série d’autres contraintes et objectifs sociaux, économiques et écologiques tout aussi importants tels que la préservation de la biodiversité, l’attention donnée au “bonheur intérieur brut” ou encore le soutien aux associations. La clé est donc de trouver le juste équilibre, remettre le profit à sa juste place et positionner l’entreprise comme contributrice à quelque chose de plus grand qu’elle, au service de l’économie, de la société et de l'environnement. Les pistes sont nombreuses : refonder ses produits et ses modalités de production ; s’organiser différemment en s’appuyant sur des mécanismes de fonctionnement plus justes qui dissipent les relations de pouvoir néfastes à tous ; préférer la coopération à la concurrence ; opter pour la sous-optimalité plutôt que la performance ; casser les logiques d’entreprises fermées et verrouillées, enfermantes et verrouillantes, qui se pensent en discontinuité avec le monde. Aux entreprises de décider par où commencer !