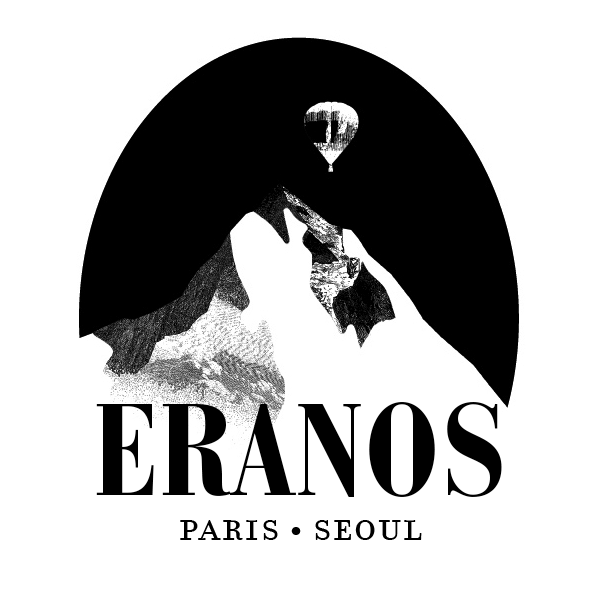Les médias spécialisés évoquent souvent un “grand divorce” entre les français et le travail. Les résultats d’une étude Fondation Jean Jaurès / IFOP (B.Bendavid et al.) suggèrent, après la pandémie, un soudain et net déclin de la fameuse “valeur-travail”, portée soit par Karl Marx, soit par Nicolas Sarkozy.
En parallèle, une nouvelle donne sociétale met la pagaille dans le management traditionnel. Attentes des collaborateurs, leadership challengé, guerre des talents, télétravail, slacking, reconversions, attrition, absentéisme, great reshuffle, et quiet quitting… Pour maintenir sa production, sa cohésion, sa performance, l’entreprise cherche donc à ré-engager ses collaborateurs. “Pourquoi les français n’aiment-ils plus leur travail” se demande-t-on ?
Pourquoi les gens partent, ou pourquoi les gens restent ?
Mais si on regarde le monde du travail ces dernières décennies (désindustrialisation, crises financières, vagues de licenciement, délocalisations, pics de chômage, recours contre les entreprises sur le plan environnemental ou social, situations de burnout, boreout…), on pourrait se demander, à l’inverse, “comment se fait-il que l’on trouve encore des salariés engagés et pour qui le travail occupe une place si importante dans leur vie ? Pourquoi les gens restent, qu’est-ce qui retient les gens ?”.
D’ailleurs, une contre-enquête sociologique détaillée fragilise la thèse d’une désaffection de la valeur-travail, et l’hypothèse d’une “grande flemme” (F.Lallemand). Combien de salariés ont le sentiment que leur travail a perdu de son sens en raison de la crise sanitaire ? Seulement 10%. Pour 61%, rien n’a changé, 29% déclarent même un regain d’intérêt (Evrest). Il n’y a pas d’épidémie de flemme. Nous observons plutôt “une accentuation des tendances antérieures qu’une rupture radicale et fondamentale” (M. Bigi, D.Méda).
Quelles sont ces tendances antérieures ? Les Français sont toujours attachés au travail, et souhaitent pouvoir s’épanouir grâce à lui. Mais la qualité du travail qu’on leur propose les amène à chercher “d’autres manières de se réaliser, de s’exprimer, de faire société” (M.Bigi, D.Méda). Dans ce cas, c’est l’entreprise qui dégrade le travail attendu.
Il ne faut donc pas essayer de réengager les français dans leur travail, dont ils se seraient désengagés. Nous devons comprendre de quel travail les français tentent de se dégager, et celui dans lequel ils restent et s’investissent.
Aime ta contrainte
En français, le travail vient du mot tripalium. C’est la croix que l’on porte, l’instrument pour immobiliser les bêtes et torturer les esclaves. Labour, labeur et l’italien lavorare renvoient à une “opération lourde”, disait Cicéron ; il faut que ce soit pénible. En russe, rabota (métier) veut dire esclavage et captivité (rab, c’est le prisonnier de guerre). L’imaginaire occidental du travail, c’est le travail-contrainte : la difficulté, l’effort nécessaire, le souci, l’inquiétude (M.Hamon).
Le XXe siècle s’affaire à atténuer la partie “contrainte” du travail-contrainte, par l’amélioration des conditions, des outils, de la sécurité. C’est le développement de l'ergonomie.
❝En aménageant le travail sans en changer l'imaginaire, nous attendons déraisonnablement que les collaborateurs aiment une chose construite et vécue comme une contrainte.❞
Avec la révolution informatique, c’est l’ennui, la perte de sens, le désengagement du corps, le déni de reconnaissance, et l’aspect répétitif des tâches que l’on essaie de vaincre. Baby-foots, chouquettes et afterworks tentent de rendre le travail plus “fun”. Le travail-contrainte devient un travail-contrainte-cool. Et puisque désormais le travail est “fun”, on s’attend à ce que les collaborateurs l’aiment. Une partie des frustrations des dirigeants vient de ce sentiment d’ingratitude : tout est pourtant fait pour rendre le travail agréable, “comment mes employés peuvent-ils continuer à se désengager” ?
Re-raconter le travail
C’est parce que pendant que nous cherchons à alléger la rudesse des tâches (ergonomie), et que nous multiplions les goodies (harcèlement du cool), nous ne changeons pas la structure profonde du récit ni de l’imaginaire du travail. En aménageant le travail sans en changer l’imaginaire, nous attendons déraisonnablement que les collaborateurs aiment une chose construite et vécue comme une contrainte.
Le problème ne se trouve pas dans la valeur que les Français accordent au travail. Il n’y a pas de mouvement de dégagement par rapport au travail. Le problème se trouve dans la capacité du travail à permettre que les Français, en tant qu’habitants du XXIe siècle et non plus du XXe, y “trouvent leur compte”, et l’inscrivent dans le récit de leur vie.
L’idée que le travail est une contrainte est partie avec l’eau du bain du XXe siècle, et la définition du travail pour les Français a évolué plus vite que la capacité des organisations à s'adapter. Si les collaborateurs se désengagent, ce n’est donc pas du travail lui-même, mais de l’imaginaire du travail-contrainte, et des entreprises qui continuent de le porter.
Cœur à l’ouvrage
Si les gens sont attachés au travail, et qu’il s’agit d’un imaginaire à changer, alors nous pouvons agir. Il y a du cœur à l’ouvrage ! Demandons-nous donc dans quel travail les collaborateurs veulent rester, dans quoi nous trouvons notre compte, ce qui nous attache au travail : du leadership, un sens d’utilité, la codétermination des tâches, le sentiment de communauté de destin, d’être à sa place, la fierté dans le geste, ou dans la transmission d’un savoir-faire, la reconnaissance de soi par les autres…
L’imaginaire du travail disait “il faut produire quelque chose qui vous est inconnu, qui ne nous appartient pas, et dont les fruits iront ailleurs”. Le travail que les entreprises doivent s’affairer à offrir maintenant, repose sur un imaginaire de l’œuvre. L'œuvre, c’est l’occupation noble, le produit de la main, le processus de fertilité vitale (H. Arendt). En disant “il faut cultiver notre jardin”, l'œuvre dit surtout : le monde, et votre production en lui, vous appartiennent.